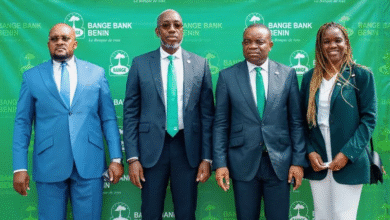Rentabilité record, risques en spirale : la microfinance CEMAC face à un tournant

Le secteur de la microfinance en zone CEMAC a enregistré en 2024 une rentabilité remarquable, avec un bénéfice agrégé d’environ 22 milliards FCFA. Près de 80 % de ces profits proviennent du Congo et du Cameroun, confirmant la forte concentration géographique du secteur. Cette progression intervient dans un contexte paradoxal où les risques se sont accrus, marqués par une hausse des créances douteuses et des fragilités persistantes au sein des établissements.
Une rentabilité en nette accélération
La microfinance régionale renoue avec une dynamique de croissance soutenue. En 2019, le résultat net agrégé ne dépassait pas 4,8 milliards FCFA. Cinq ans plus tard, atteindre 22 milliards révèle un redressement spectaculaire, porté notamment par l’expansion continue du crédit, en hausse d’environ 9 % en 2024.
Certaines institutions ont montré une forte capacité d’adaptation, grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et à l’élargissement vers des segments historiquement sous-financés comme l’agriculture et le monde rural. Cette combinaison de maîtrise des coûts, d’augmentation du portefeuille et de rigueur financière explique une partie du bond de rentabilité.
Congo et Cameroun : les deux moteurs du secteur
La prédominance du Cameroun et du Congo demeure écrasante. Le Cameroun concentre près des trois quarts des établissements de microfinance du bloc, soit plus de 380 institutions, tandis que le Congo dispose d’un réseau coopératif puissant qui capte une part significative des dépôts régionaux.
En 2024, environ 85 % du volume total de crédits émis dans la CEMAC provenait des microfinances camerounaises et congolaises. Ce poids structurel explique que l’essentiel des bénéfices soit généré dans ces deux économies, tandis que les autres pays demeurent en retrait, faute de réseaux d’une taille comparable ou de performances financières significatives.
Un revers préoccupant : la montée des créances douteuses
L’envers du tableau se trouve dans la qualité du portefeuille. Les créances en souffrance ont dépassé 178 milliards FCFA en 2024, un niveau inédit. Le Cameroun concentre plus de 80 % de ce volume, conséquence logique de son poids, mais aussi reflet d’un risque de crédit élevé affectant les ménages et microentreprises.
La situation est d’autant plus préoccupante que plusieurs indicateurs prudentiels se sont fortement dégradés. Près d’un quart des établissements n’atteignent plus le seuil réglementaire de couverture des risques, et plus d’un tiers affichent un ratio de liquidité inférieur aux exigences. Ces vulnérabilités ont conduit à une vague d’assainissement : retraits d’agrément, fermetures d’institutions et mises sous administration provisoire, notamment dans les marchés les plus dynamiques.
Politiques publiques, régulation et digitalisation : les leviers clés
La progression de la rentabilité résulte aussi de facteurs structurels. Les stratégies nationales d’inclusion financière ont stimulé la demande de services financiers. Les États ont multiplié les programmes de soutien aux microcrédits productifs, renforçant l’activité des institutions.
Parallèlement, la régulation s’est durcie. Le renforcement du contrôle interne, des normes de gouvernance et de capitalisation a éliminé de nombreux acteurs fragiles, clarifiant le paysage au profit des institutions les plus solides.
La digitalisation représente un troisième levier majeur. L’essor du mobile money et l’intégration des services numériques permettent de réduire les coûts, d’étendre les services dans les zones peu couvertes et d’améliorer le suivi du risque grâce à une meilleure exploitation des données. Les établissements qui ont accéléré leur transformation numérique sont aujourd’hui parmi les plus performants.
Perspectives : capitaliser sur les gains, maîtriser les vulnérabilités
L’année 2024 marque un tournant pour la microfinance en Afrique centrale. Le secteur démontre qu’il peut concilier inclusion financière et performance économique. Les prochains défis seront déterminants : renforcer la gouvernance, améliorer la qualité du portefeuille, restaurer la confiance des épargnants et encourager les consolidations entre petits acteurs pour bâtir des réseaux plus solides.
Si la discipline financière s’accentue, si la digitalisation s’approfondit et si les États calibrent mieux leur soutien, la microfinance CEMAC pourrait transformer cette embellie ponctuelle en croissance durable. La capacité du secteur à maîtriser ses risques conditionnera son rôle dans le financement des petites entreprises, de l’agriculture et de l’économie populaire dans les années à venir.
Patrick Tchounjo