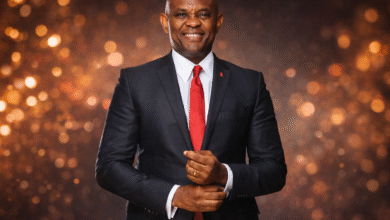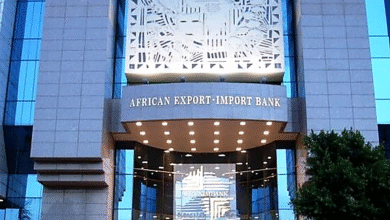Cameroun : 7 500 milliards FCFA engagés et une loi à réformer pour rendre l’investissement privé vraiment productif

En présentant devant les députés le nouveau projet de loi sur l’incitation à l’investissement privé, le ministre de l’Économie, Alamine Ousmane Mey, a reconnu ce que beaucoup d’acteurs économiques et institutionnels disent depuis plusieurs années : la loi de 2013, censée être le socle de la politique d’attraction des capitaux, n’a pas tenu toutes ses promesses.
Devant l’Assemblée nationale, le ministre a rappelé que, dans le cadre de la loi de 2013, 424 conventions d’investissement ont été signées, représentant environ 7 504 milliards FCFA d’engagements pour 168 000 emplois annoncés. Un volume qui semble impressionnant sur le papier, mais dont l’efficacité réelle reste largement questionnée. « Ce n’est pas suffisant, nous le savons », a-t-il concédé, en justifiant le dépôt d’un nouveau texte par la nécessité de « moderniser notre corpus juridique […] pour maintenir le cap de l’émergence ».
Un bilan chiffré… mais en demi-teinte
Derrière ces montants affichés se cache un décalage important entre les intentions et les réalisations. Selon les données de l’Agence de promotion des investissements (API), entre 2014 et 2022, seulement 1 764 milliards FCFA ont été effectivement investis sur les 2 856 milliards FCFA annoncés dans les conventions, soit un peu plus de 60 % de réalisation.
Sur le front de l’emploi, le décalage est encore plus frappant : 14 354 emplois créés pour 42 697 promis. Autrement dit, à peine un tiers des engagements en matière d’emploi se sont matérialisés.
Ces chiffres traduisent une réalité que le gouvernement ne peut plus ignorer : la loi de 2013 a surtout produit un important stock d’exonérations fiscales, sans garantie systématique d’investissement réel ni d’impact significatif sur la transformation structurelle de l’économie.
Une réforme sous contrainte du FMI
La révision de la loi n’est pas qu’une initiative technique interne ; elle est aussi la conséquence directe d’un engagement vis-à-vis des bailleurs, au premier rang desquels le Fonds monétaire international (FMI).
En janvier, dans le cadre d’un appui financier de 77,5 milliards FCFA, le FMI a clairement demandé au Cameroun de revoir la loi de 2013 pour rationaliser les incitations à l’investissement. Le gouvernement reconnaît que cette révision conditionne le déblocage de futures tranches d’appui financier.
Le projet de loi précise d’ailleurs que cette réforme fait partie des actions préalables obligatoires avant le 15 juin 2025, dans le cadre de la 8ᵉ revue du Programme économique et financier. Le message est clair : la politique d’incitations fiscales doit être mieux maîtrisée, mieux ciblée et plus étroitement évaluée, faute de quoi elle risque d’aggraver une situation budgétaire déjà sous tension.
Une loi critiquée pour son inefficacité fiscale et sa dispersion
Depuis près de dix ans, la loi de 2013 concentre les critiques du secteur privé comme des institutions financières internationales.
Le patronat, à travers le Gecam, juge que le dispositif affiche un bilan largement en deçà des attentes. Les exonérations accordées auraient entraîné des pertes fiscales importantes, sans retombées économiques proportionnelles ni en termes de valeur ajoutée, ni en termes de modernisation industrielle. Dans certains cas, les incitations auraient même favorisé des secteurs à faible productivité, au détriment d’activités plus stratégiques.
La Banque mondiale va dans le même sens : dans un rapport de 2022, elle estime que le coût budgétaire des exonérations est supérieur aux bénéfices économiques générés, suggérant une dépense fiscale peu productive.
Au cœur du problème, on retrouve une ouverture quasi générale des secteurs éligibles, des critères d’éligibilité trop larges qui laissent entrer des projets peu structurants, et des mécanismes de suivi et de contrôle insuffisants pour vérifier la réalité des investissements et des emplois.
Résultat : les avantages fiscaux ont été dilués dans une multitude de projets, sans effet de levier massif sur la transformation de l’appareil productif.
Ce que change le nouveau texte : recentrage, sélectivité et contrôle
Face à ce constat, le gouvernement affirme avoir procédé à une refonte profonde du dispositif. Le nouveau projet de loi introduit plusieurs inflexions majeures, censées corriger les dérives des dix dernières années.
D’abord, la réforme consacre un référentiel unique, qui devient la base de tous les régimes d’incitations à l’investissement. L’objectif est d’harmoniser les dispositifs, d’éviter la superposition de régimes spéciaux et d’améliorer la lisibilité pour les investisseurs.
Ensuite, les critères d’éligibilité sont revus et renforcés. Le texte prévoit un recentrage sur des zones de développement prioritaires, ce qui permet de territorialiser et de mieux cibler les avantages, notamment dans les régions à fort potentiel agricole, industriel ou logistique mais jusque-là sous-investies.
Sur le plan fiscal, la réforme introduit un changement de paradigme : il s’agit de passer d’un système de réductions ou d’exonérations d’impôts à un mécanisme de crédit d’impôt. Ce dernier est considéré par le gouvernement et ses partenaires comme un instrument plus efficace pour maîtriser la dépense fiscale, car il est plus facilement mesurable et conditionnable à des réalisations concrètes, qu’il s’agisse d’investissements effectifs, d’emplois créés ou d’exportations.
Autre innovation, les entreprises publiques deviennent éligibles aux incitations dès lors qu’elles opèrent dans des secteurs concurrentiels. L’objectif affiché est d’éviter de pénaliser des acteurs publics engagés dans des projets structurants, notamment dans l’énergie, les transports ou l’agro-industrie, par rapport à leurs concurrents privés.
La réforme prévoit également la création d’un guichet unique, censé simplifier et accélérer les procédures d’agrément, ainsi que la mise en place d’un comité d’audit chargé du suivi des conventions, du contrôle des engagements réels et du règlement des différends.
Pour Alamine Ousmane Mey, cet ensemble de mesures doit permettre à l’État d’utiliser davantage ces ressources pour soutenir les investissements susceptibles de favoriser la transformation structurelle du Cameroun et de promouvoir la politique d’import-substitution.
Un tournant pour la politique industrielle camerounaise
En arrière-plan, la réforme de la loi sur l’investissement privé traduit un tournant stratégique : le Cameroun cherche à passer d’une logique de générosité fiscale diffuse à un modèle d’incitations ciblées, évaluées et conditionnées.
Le recours aux crédits d’impôt, l’introduction de zones prioritaires et le renforcement des mécanismes de contrôle signalent une volonté de mieux aligner la politique d’incitations sur les objectifs de la Stratégie nationale de développement 2020–2030 (SND30), à savoir l’industrialisation, la montée en gamme de l’offre locale, la substitution progressive aux importations et la création d’emplois qualifiés.
Reste une question clé : la capacité d’exécution. La réussite de la réforme dépendra moins de l’architecture du texte que de la coordination entre les administrations fiscales, douanières, sectorielles et l’API, de la capacité du guichet unique à fonctionner comme une véritable interface et non comme une couche supplémentaire de bureaucratie, et de la rigueur du comité d’audit ainsi que de sa réelle autonomie pour sanctionner les dérives.
Si le nouveau dispositif est correctement appliqué, il pourrait clarifier le climat des affaires, limiter les rentes fiscales injustifiées et redonner de la crédibilité à la politique industrielle du Cameroun. À l’inverse, une mise en œuvre partielle ou politisée risquerait de reproduire les mêmes travers que la loi de 2013, en changeant la forme sans transformer le fond.
Patrick Tchounjo