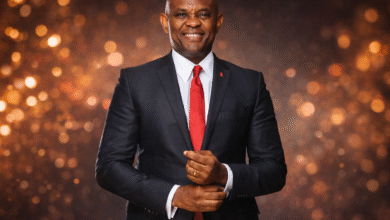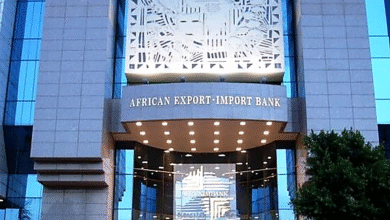Cameroun : avec la garantie d’Afreximbank, l’État lève 159 milliards FCFA auprès des banques locales et réinvente sa stratégie d’endettement

Le Cameroun a choisi d’élargir encore un peu plus la palette de ses instruments de dette. Selon la note de conjoncture sur la dette publique arrêtée à fin septembre 2025, publiée par la Caisse autonome d’amortissement (CAA), l’État a mobilisé 159 milliards de FCFA auprès de banques locales, avec le soutien décisif d’une garantie partielle ou totale d’Afreximbank. L’identité des établissements prêteurs n’est pas dévoilée, mais le message politique et financier est clair : Yaoundé s’appuie désormais sur l’ombre portée d’une grande institution panafricaine pour continuer à emprunter, sans trop tendre la corde de la confiance domestique.
Cette opération s’inscrit dans le cadre fixé par la loi de finances rectificative 2025, qui autorise jusqu’à 250 milliards de FCFA d’emprunts bancaires locaux garantis par Afreximbank. À ce stade de l’exercice, le Trésor disposerait donc d’une marge résiduelle théorique de 91 milliards de FCFA à mobiliser, sauf révision à la baisse des besoins ou changement de stratégie.
Un deuxième soutien majeur d’Afreximbank en 2025
Ce nouveau prêt garanti n’est pas un geste isolé. Il intervient quelques mois seulement après une autre opération structurante : le 30 juin 2025, Afreximbank avait déjà permis au Cameroun de lever 200 milliards de FCFA sur le marché sous-régional des titres publics, piloté par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).
Le montage retenu reposait sur un schéma sophistiqué : une opération de swap par laquelle Afreximbank convertissait une partie de ses ressources en euros en FCFA auprès de la BEAC, à hauteur de 200 milliards. Ces fonds étaient ensuite utilisés pour souscrire une émission d’obligations du Trésor assimilables (OTA) du Cameroun, rémunérées entre 6,5 % et 7,5 %. En pratique, l’institution panafricaine endossait à la fois le rôle de pourvoyeur de devises, d’investisseur institutionnel et de catalyseur de confiance.
Cette opération a marqué un précédent : Afreximbank est devenue la première institution financière étrangère à intervenir directement sur le marché des titres publics de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique). Dans un environnement jusque-là dominé par les banques locales, souvent proches de la saturation, l’arrivée d’un acteur non-résident de cette taille a été perçue comme un tournant.
Emprunter « chez soi » avec un filet de sécurité panafricain
Les 159 milliards de FCFA nouvellement mobilisés relèvent d’une logique complémentaire. Il ne s’agit plus d’une souscription directe d’obligations par Afreximbank, mais d’un recours aux banques locales, dont l’appétit est démultiplié par la présence d’une garantie.
Dans un marché où les établissements bancaires sont déjà massivement exposés aux titres publics, la garantie d’Afreximbank joue un rôle clé. Elle permet de limiter le risque perçu par les banques, en tout ou partie, de réduire la prime de risque exigée pour prêter à l’État et donc, en principe, d’abaisser le coût effectif de l’emprunt pour le Trésor.
Le dispositif s’apparente à un mécanisme de partage des risques : les banques locales mobilisent leur liquidité, mais une partie du risque final est portée, ou au moins mutualisée, par une institution panafricaine aux fonds propres plus robustes et à l’horizon de long terme affirmé.
Une stratégie assumée de diversification des sources d’endettement
En combinant emprunts domestiques garantis et innovations de marché (swap, intervention directe d’un investisseur étranger), le Cameroun cherche à diversifier ses voies de financement et à réduire sa dépendance aux canaux traditionnels : émissions régulières de titres publics sur le marché BEAC, crédits projet bilatéraux, lignes multilatérales FMI/Banque mondiale, eurobonds.
Cette diversification répond à plusieurs impératifs.
D’abord, un impératif de volume : les besoins de financement du budget et des investissements publics restent élevés, tandis que les marges de manœuvre fiscales demeurent limitées. Dans un contexte de consolidation budgétaire encadrée par le FMI, l’option la plus réaliste est d’optimiser les conditions d’accès à la dette plutôt que de renoncer à certains projets.
Ensuite, un impératif de coût : la garantie d’Afreximbank vise à réduire la perception de risque souverain auprès des prêteurs locaux, ce qui, en théorie, permet de négocier des conditions plus favorables en termes de taux, de maturités et de profil d’amortissement que si l’État se présentait seul.
Enfin, un impératif de signal : en s’affichant comme partenaire structurant d’un État CEMAC, Afreximbank envoie un message aux autres investisseurs non résidents susceptibles d’entrer sur le marché régional des titres publics. La présence d’un acteur de référence diminue l’isolement de la place sous-régionale et offre un premier repère en matière de pricing et de structuration.
George Elombi, symbole camerounais à la tête d’Afreximbank
Cette montée en puissance d’Afreximbank dans l’architecture financière camerounaise intervient au moment où l’institution s’est dotée, depuis le 28 juin 2025, d’une nouvelle direction portée par le juriste camerounais George Elombi. Sa nomination n’est pas anecdotique : elle renforce, au plan politique comme symbolique, le lien entre le Cameroun et la banque panafricaine.
Pour Yaoundé, bénéficier du soutien d’une institution désormais dirigée par un ressortissant national est autant une opportunité qu’une responsabilité. Toute perception de favoritisme serait scrutée de près par les autres États membres. À l’inverse, une collaboration jugée exemplaire et bien encadrée pourrait servir de modèle pour d’autres pays de la sous-région en quête de nouveaux outils de financement.
Les promesses et les risques d’un modèle fondé sur la garantie et le marché
À court terme, le recours à des emprunts bancaires garantis par Afreximbank présente des avantages évidents pour l’État. Il permet d’accéder à la liquidité locale sans épuiser totalement les capacités d’absorption des banques, puisque la présence du garant améliore le profil de risque de l’opération. Il peut aussi optimiser le coût moyen de la dette, en combinant des taux plus bas et des maturités plus ajustées aux besoins de trésorerie.
À moyen terme, la stratégie pourrait contribuer à attirer davantage d’investisseurs non résidents sur le marché CEMAC, à allonger la duration des titres et à réduire le risque de refinancement permanent, ainsi qu’à dynamiser la courbe des taux en introduisant de nouveaux profils d’investisseurs et de nouvelles attentes de rendement.
Mais ces promesses ont leurs contreparties. L’utilisation récurrente de garanties souveraines ou quasi-souveraines engage l’État au-delà des chiffres visibles de la dette. Les engagements hors bilan liés aux garanties doivent être rigoureusement suivis, consolidés et rendus transparents, sous peine de créer des zones d’ombre dans l’évaluation du risque souverain.
Par ailleurs, l’abondance de financements sécurisés pour l’État pose la question des effets d’éviction : à quel point l’accès facilité au crédit public peut-il comprimer la disponibilité du crédit pour le secteur privé, en particulier les PME, dans un système bancaire déjà très exposé à la signature souveraine ?
Discipline d’endettement et coordination avec la BEAC : conditions clés
Pour que cette stratégie reste soutenable, plusieurs conditions apparaissent essentielles.
La première est la discipline d’endettement. La possibilité de lever des fonds avec une garantie panafricaine ne doit pas être perçue comme un blanc-seing à l’accumulation de dettes. La trajectoire globale du ratio dette/PIB, la structure par maturité et par devises, ainsi que la capacité réelle du budget à absorber la charge d’intérêts restent les vrais juges de paix.
La deuxième condition est la transparence. Les autorités doivent documenter clairement la nature des garanties d’Afreximbank, leur durée, leurs déclencheurs et leur incidence potentielle sur la dette future. Sans cette transparence, la confiance des marchés internationaux, déjà fragile, pourrait pâtir d’une perception de risques cachés.
La troisième est la coordination avec la BEAC. En tant que banque centrale de la sous-région, la BEAC doit veiller à ce que ces dispositifs d’ingénierie financière n’aboutissent pas à une raréfaction de la liquidité disponible pour le secteur privé, ni à une distorsion excessive de la structure des taux. La frontière est fine entre soutien au financement public et sur-sollicitation des ressources bancaires au détriment de l’économie réelle.
Un laboratoire de la nouvelle finance publique africaine
À bien des égards, le cas camerounais illustre une tendance plus large en Afrique : la recherche, parfois contrainte, de montages hybrides combinant garanties panafricaines, innovations de marché et recours intensif aux banques locales. Dans un monde où l’accès aux eurobonds est plus incertain, où les marges budgétaires sont serrées et où les programmes d’ajustement imposent leurs conditions, les États testent de nouvelles formes de financement.
Le Cameroun, avec ces 159 milliards de FCFA garantis par Afreximbank et les 200 milliards de FCFA levés via un swap sur le marché des titres publics, se place ainsi au cœur d’un laboratoire de la nouvelle finance publique africaine. Reste à savoir si les leçons de ce laboratoire seront positives — diversification maîtrisée, coûts raisonnables, transparence accrue — ou si elles se traduiront par une complexification de la dette souveraine, plus difficile à suivre et à piloter.
Pour l’instant, le pari est ouvert. Mais une chose est certaine : l’ombre portée d’Afreximbank sur la dette camerounaise va continuer de peser dans les discussions sur la soutenabilité budgétaire, le rôle des marchés régionaux et la place des banques locales dans le financement de l’État.
Patrick Tchounjo